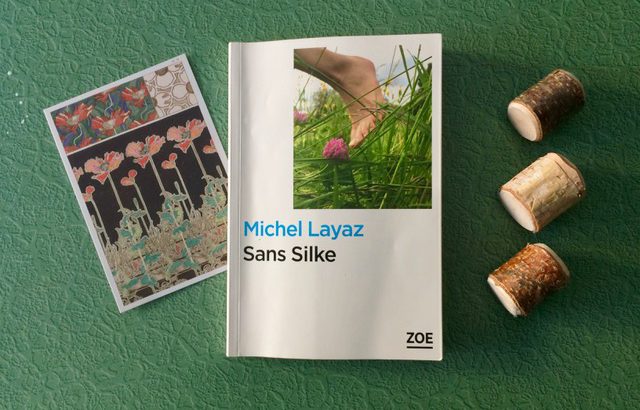« Dans une semaine, j’emménage chez une femme avec qui j’ai parlé durant quarante-cinq minutes pour m’occuper d’une Ludivine inconnue dont le père est resté invisible. »
Dès son arrivée à La Favorite, la narratrice éponyme de Sans Silke de Michel Layaz prend conscience de la curieuse dynamique familiale avec laquelle elle va devoir composer. Dans son nouveau roman paru aux éditions Zoé, l’auteur fribourgeois reprend l’étude d’un thème qui traverse son œuvre : la famille. À travers le regard de Silke, il observe les répercussions de l’amour absolu que se portent des parents. Alors âgée de dix-neuf ans, la jeune femme décide de prendre un poste de gardienne d’enfant, tout en poursuivant ses études universitaires. Une expérience formatrice qui la marquera au point que, vingt ans plus tard, elle éprouve le besoin de revenir sur le temps passé avec cette famille singulière. La mère, une brillante avocate avec de prodigieux talents culinaires, est accaparée par le bien-être du père. Tandis que, ce dernier, archétype même de l’artiste égocentrique, n’a que « deux grandes amours » : son atelier et sa femme. Jugée par sa mère comme étant une enfant « endormie », Ludivine semble n’attendre que la venue de Silke pour s’éveiller. Une amitié basée sur le partage d’un imaginaire commun ne tarde pas à se nouer entre elles. Toutefois, Silke ne pourra pas empêcher le drame qui mettra abruptement fin à son séjour à La Favorite.
Tout au long de Sans Silke, le nom de la maison de maître dans laquelle Layaz choisit d’établir son récit revient inlassablement hanter le propos de la narratrice. Plus qu’un simple cadre, la demeure reflète le (dys)fonctionnement familial. Le nom de « Favorite » signale d’emblée le régime malsain sous lequel évolue la famille qu’intègre Silke. Cependant, les parents ne se contentent pas de favoriser leur vie de couple. Si, dans certaines familles, les enfants sont rois, cela n’est définitivement pas le cas pour Ludivine. Obsédé par son art, le père est l’élément central autour duquel s’articule le quotidien de la famille. Sa femme semble n’exister que pour lui, au point de perdre de vue la distinction entre mère et épouse. Suite à l’insuccès du mari lors de l’un des rares vernissages auquel il participe, son dévouement à le réconforter prend des allures maternelles. « Plus que d’habitude encore, la mère le chouchoutait et le réconfortait. S’il y avait un enfant à La Favorite, son prénom n’était pas Ludivine. » De cette implacable simplicité qui caractérise son écriture, Layaz souligne jusqu’où peut aller la sourde violence du favoritisme : l’usurpation à un enfant de son statut au sein de sa propre famille. Le romancier nous fait aussi indirectement comprendre l’importance du rôle de la mère dans la dynamique familiale. Figure de balancier entre le père et sa fille, elle pourrait être en mesure de rétablir l’équilibre. Si seulement, elle n’accordait pas tout son amour à son mari.
Mais Ludivine ne pourra jamais rivaliser avec la passion que ses parents se portent. À dix ans, la fillette ne répond pas aux espérances de sa mère. C’est avec effroi que Silke reçoit les confidences de cette dernière : « Ludivine n’a pas le physique de la jeune fille idéale que j’imaginais pouvoir admirer jour après jour, mois après mois. Et jamais elle ne l’aura. » Sa mère ne pouvant surmonter sa déception, Ludivine ne peut pas être le véritable fruit du bonheur conjugal de ses parents. Pourtant, un amour si grand se doit de ne pas rester sans monument érigé à sa gloire. Ici se révèle la terrifiante splendeur que Layaz prête à La Favorite. La villa familiale n’évoque pas seulement le favoritisme ambiant, elle est une véritable ode à l’amour des parents. « Les objets se regardaient, se rencontraient et se faisaient de l’œil à travers les âges. Tout rimait et tout concordait. » La maison permet aux parents d’atteindre la perfection qu’ils n’ont pu réaliser en concevant leur propre enfant. Dans la froide beauté de ce temple, Ludivine peine à trouver sa place.
Dans Sans Silke, Layaz joue magnifiquement sur le contraste qu’offrent l’intérieur et l’extérieur de La Favorite. À l’oppression diffuse qui s’inhale de pièce en pièce, il oppose la franche liberté du jardin bordé par la forêt. Quand elle n’occupe pas sa chambre, Ludivine est dehors. Et c’est, abritée par le feuillage des arbres, la joue collée contre leur écorce qu’elle donne libre cours à sa fantaisie. « Elle aimerait seulement que les traces de sa joue et de ses mains se gravent dans l’écorce. » Comme en réponse au matérialisme savamment étudié de ses parents, la petite fille développe un goût prononcé pour la nature. Silke (re)découvre à ses côtés le bonheur du vagabondage en forêt, l’observation patiente de la vie animale et les vertus d’une imagination sans limite. À travers le personnage de Ludivine, c’est une réelle poétique de l’enfance que Layaz élabore. Les propos de la fillette sont d’une franchise douloureusement candide, tandis que son inventivité foisonnante ouvre la porte d’un univers où une féérie fantasque ne dissimule jamais totalement la brutalité mordante de la réalité. Une fin d’après-midi, Ludivine s’érafle le poignet et déclare à Silke : « Si un jour je perds beaucoup de sang et qu’à l’hôpital on me donne le sang des oiseaux, alors je pourrai voler. »
La relation que tissent la jeune femme et la fillette a une grande influence sur l’évolution de l’une et de l’autre. À l’ombre bienveillante du regard de la narratrice, la personnalité de Ludivine peut se révéler et s’épanouir. Silke flotte, elle, dans une période de transition. « J’avais l’âge des métamorphoses récentes : dix-neuf ans », précise-t-elle. Au fil des pages, elle développe une passion pour la photographie qu’elle réalisera après son séjour à La Favorite. La façon dont Layaz construit son roman atteste d’ailleurs du lien entre écriture et photographie : les chapitres se donnent à lire comme des scènes de vie capturées par un objectif. Mais à travers le prisme de Silke, ces instantanés ne livrent jamais une sensation de figement. Le sens artistique que la narratrice voit éclore au contact de la lumineuse créativité de Ludivine compose avec la vie, l’infuse. Ce à quoi s’oppose la peinture dénuée d’affect du père. Ce dernier reste dans le superficiel, enfermé sur lui-même et sur son propre désir de création. Avec lui, l’art ne se fait jamais chair, il ne reste qu’une lettre stérile et inanimée. C’est ce que Silke comprend lors d’un échange avec lui : « Le père dévorait mes mots. Il se précipitait sur l’un ou l’autre, lâchait un flux de paroles où déboulaient en vrac ses convictions, ses sources, ses espoirs ou ses plaintes. » La créativité du père ne va jamais qu’à la rencontre de son propre égo.
Avec Sans Silke, Layaz fait se rencontrer histoire de famille et réflexion sur l’art. Son nouveau roman lui permet d’explorer avec finesse l’importance de l’apport du monde extérieur sur la création artistique mais aussi sur le lien familial, surtout quand ce dernier est rongé de failles. On ne ressort en tout cas pas indemne de cette sublime exploration, l’écho des rires de Silke et Ludivine résonant encore à nos oreilles avec une douce amertume, alors que s’achève la lecture de la dernière page.
Camille Bernasconi
Michel Layaz, Sans Silke, Éditions Zoé, 2019, 157 pages.