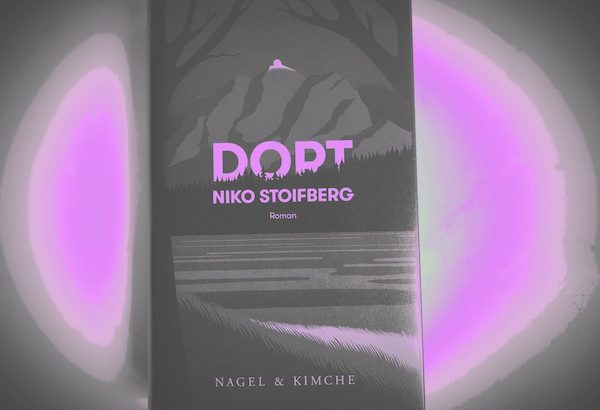Pour provoquer son propre bonheur, est-on en droit de sacrifier celui des autres ? Telle est la question que le Lucernois Niko Stoifberg pose avec Dort (« Là-bas »), son premier roman. Par chance, il n’en reste pas là, et poursuit son exploration avec des interrogations plus profondes.
Grâce à son concept Nature directe, Sebi, un horticulteur à la mode, est en passe de devenir internationalement reconnu. Son idée est pourtant simple : en proposant de relier, au moyen de passerelles en bois, des maisons à la nature environnante, il agit en parfait accord avec l’esprit minimaliste dominant. Tout comme Sebi, fils d’un pilote militaire, Lydia est issue d’une bonne famille. Sa mère est hôtelière et son père, décédé, était un architecte de renom. Elle vit dans le quartier bourgeois de la ville et poursuit un projet similaire à celui de Sebi, bien que dans un autre domaine : elle photographie des aliments crus. Mais leurs projets d’avenir et la monotonie de leur vie (#minimalism) seront bientôt sensiblement troublés.
Quand ils se croisent un soir, Sebi est soudain frappé de certitude : « C’est elle, c’est elle qui me manquait ». Voulant simuler un acte héroïque, il pousse le petit frère de Lydia dans le lac, prêt à sauter à sa suite. Mais sa tentative de sauvetage échoue et le petit garçon meurt. Lydia lui est néanmoins reconnaissante d’avoir tenté de le secourir et cherche à se rapprocher du prétendu sauveur. Hanté par la culpabilité, il confesse son acte à mots couverts ; cette imprudente confidence, tombée dans la mauvaise oreille, aura des conséquences insoupçonnées.
Divulguer ici la suite de l’intrigue serait trahir la dramaturgie de ce livre, aussi surprenante que savamment élaborée. Mais on peut encore dévoiler ceci : cette noyade provoquée n’est que le début d’une longue série de retournements et d’amplifications qui font de ce récit un thriller haletant. Stoifberg zigzague entre cauchemar et cauchemar éveillé. Sebi est toujours contraint de se demander : « Suis-je en train de rêver ? » Il vivra pêle-mêle une descente dans les entrailles d’un ours, un internement dans un bunker et des rencontres avec des ouvrier·ère·s lépreux·ses.
Si dans la trame, mystères et divagations s’accumulent, la langue de Stoifberg fonctionne elle aussi par intensification. Dans les descriptions comme dans les dialogues, plus aucune trace de l’élégance et de la concision de nature directe : les parataxes se superposent. Interjections, flux de conscience effrénés et rires sataniques empêchent toute contemplation moralisatrice de l’acte de Sebi, et révèlent d’autres niveaux d’analyse. La question de savoir si, pour son propre bonheur, on est en droit de sacrifier le bonheur des autres devrait dès lors être remplacée par la suivante : est-on vraiment toujours maître de son propre destin ? Il en va de même pour les jugements simplistes des lifestyles minimalistes : Stoifberg se gausse de cette tendance – ainsi que de toutes celles qui vantent l’accès à la sérénité – comme d’une tentative désespérée de restaurer, via des schémas réducteurs et stériles, un sujet déjà bien morcelé.
Sur la quatrième de couverture, on peut lire un commentaire de Rolf Dobelli, auteur à succès dans le domaine du coaching et employeur régulier de Stoifberg. Si son avis peut se révéler trompeur, la question de la culpabilité et de l’expiation est heureusement tout aussi superficielle : c’est bien plus une réflexion approfondie autour de l’inconscient et de ce que l’on nomme « les abîmes de l’esprit » que sous-tend cette intrigue palpitante. Là réside toute la radicalité de ce livre, véritable évènement de lecture.
Dino Tsamilakis
[Traduit de l’allemand par Camille Logoz]
Niko Stoifberg, Dort, Zürich, Nagel & Kimche 2019, 328 p., env. 36 CHF