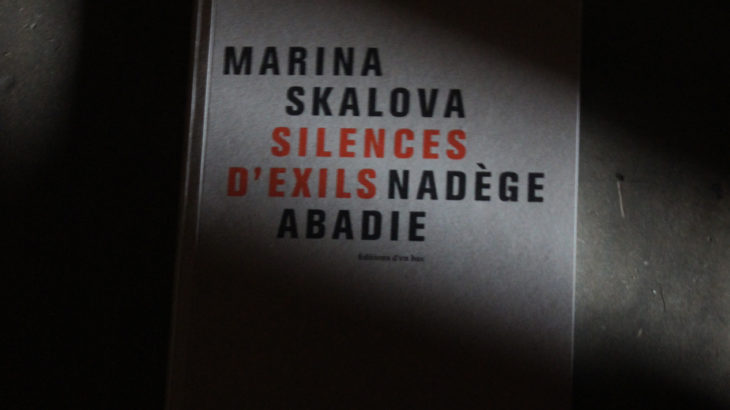La langue est affaire d’appropriation. Il s’agit, comme le disent si bien les mots de Philippe Rahmy placés en exergue, d’occuper une position au moyen du langage, de conquérir un lieu. Mais que faire lorsqu’une destinée – des déserts parcourus, des mers traversées – nous a arraché les outils nécessaires à l’expression ? Comment dire la perte et le vide, l’indicible ? Ce que l’on ne peut pas dire il faut le taire, dit Wittgenstein. Mais comment, dès lors, donner corps à ce silence ?
Le projet Silences d’exils, mis sur pied en 2016 par l’écrivaine Marina Skalova et la photographe Nadège Abadie, est né de ces réflexions. Entre Genève, Bienne et Fontainemelon, dans le canton de Neuchâtel, les deux jeunes femmes ont proposé des ateliers d’écriture et de photographie à des réfugié·e·s. Les textes et les images créés lors de ces rencontres ont donné lieu à plusieurs expositions en 2017 et 2018 puis à la publication de ce livre, paru en juin 2020 aux Éditions d’en bas.
Originaires d’Afghanistan, de Syrie, d’Irak, d’Érythrée, d’Iran et d’ailleurs, les participant·e·s parlent arabe, dari, pachto, farsi, hindi, espagnol et, pour la plupart, un petit peu français. Ce peu, parfois si proche du rien, permet tout de même l’échange ainsi qu’un premier constat. Toutes et tous sont là, en Suisse, comme dans une interminable salle d’attente, mais personne ne se sent à sa place. Quelque chose est faux, dit Abbas, un réfugié syrien. Si j’avais eu le choix, je ne serais pas parti. Ce sentiment – Marina Skalova en est consciente – découle entre autres d’un rapport conflictuel avec la langue et la parole. Prendre une langue c’est prendre une place, rappelle-t-elle en se remémorant son propre vécu. La langue est affaire d’autorisation. Une autorisation, c’est précisément ce que souhaitent offrir ces ateliers ; un espace commun et partageable, à mi-chemin entre les deux femmes et les exilé·e·s, une place dans l’entre deux langues.
Cet espace médian est comme un fleuve dont chaque rive, bien délimitée, représente une langue ; un fleuve qui relie. Un pied dans l’eau, les animatrices tendent la main et invitent chacun et chacune à les rejoindre, avec ses propres mots. Ali ouvre le bal : Nyogi na pigri – Nous on est allés pêcher. Par association sonore, Marina lui emboîte le pas : Alors moi, ça me fait penser à une chose : yoga en pyjama. Puis Ali renchérit : Yoghourt en pensée, et ainsi de suite. Le contenu importe peu, c’est la forme qui prédomine et rend sensible la proximité entre des langues a priori très différentes les unes des autres. Au fil des jours et des exercices proposés, les réflexions qui naissent sous la plume de Marina Skalova au contact des migrant·e·s se construisent autour de cette matérialité : la proximité entre l’espagnol mi regreso – « je retourne au pays » – et le français régresser, les liens qui rapprochent l’attente, la tente, l’attentat, l’atteinte et la teinte ou encore le léger glissement qui mène de l’arabe djazira – « beaucoup » à djazila – « l’île ». Une île comme la Suisse ? demande l’écrivaine, pour elle-même. Chaque langue est incomplète et a besoin de la présence des autres pour s’enrichir, comme nous.
Une fois la brèche ouverte, le partage est possible. Les exercices proposés invitent alors chaque participant·e à se replacer dans une trajectoire temporelle. On se remémore le passé à partir de la formule Je me souviens…, inspirée de Georges Perec, avant d’évoquer les endroits où l’on vit, où l’on aimerait vivre, où peut-être, un jour, on va vivre. Écrire s’apparente ainsi à une mise en mouvement – de soi et pour soi – contre l’immobilité de l’attente : attente d’un passeport, d’un permis, d’un travail ; attente souvent d’un renvoi. Toutefois, la parole ne va pas de soi. Lorsqu’elle parvient à se frayer un chemin du cœur jusqu’à la bouche, c’est souvent pour se heurter aux creux, aux fautes et aux lacunes, à la honte de ne pas savoir que dire, de ne pas savoir comment dire. Le témoignage n’est alors qu’une brève éruption entre deux longs silences, là où justement la langue ne peut plus être. Il faudrait un mur pour la soutenir, affirme Marina Skalova. Mais il n’y a pas de mur. La langue c’est le mur. Heureusement, les silences et les hésitations en disent parfois plus long que les mots. Omar peine à s’exprimer en bon français, il espère que Marina saura traduire le fond de sa pensée. Pourtant, elle en est convaincue, ses structures de phrases hachées me racontent plus que leur contenu. Plus que dans les mots, le cœur de ces ateliers semble ainsi battre dans les creux, entre les lignes, dans les sourires en pointillé et les cassures de la voix.
L’humanisme, le courage et la passion qui ont animé Marina Skalova et Nadège Abadie tout au long du projet Silences d’exils ne pouvaient que donner lieu à une publication d’une force extraordinaire. Textes et photos, voix d’ici et d’ailleurs s’entremêlent dans plus de 150 pages reconstituant un espace de l’entre deux. Là encore, la forme en dit autant que le contenu. Chaque page reproduit la langue et ses hésitations, avec ses marges et ses fractures, ses blancs qui rendent palpable le silence, ses points de suspension qui donnent une forme à l’invisible et à l’inaudible. Les paragraphes descriptifs et narratifs sont justifiés, réguliers ; rien ne dépasse, ils semblent définitifs. Au contraire, les témoignages des exilé·e·s et les réflexions de Marina Skalova sont ouverts. Chaque ligne est unique et semble prête à outrepasser la marge pour s’étendre en dehors du livre, à l’infini. Il en va de même des numéros de pages. Fermés à gauche (et seulement à gauche) par un crochet, ils offrent à chaque page une potentialité accrue, donnant eux aussi forme aux silences, l’air de dire il y a ça oui, mais il y a beaucoup plus encore.
Les photos qui occupent, ponctuellement, l’espace d’une double-page prolongent le discours des mots. Quel qu’en soit le sujet, elles montrent à chaque fois la même chose : des couleurs qui s’entremêlent, malgré les contrastes qui les opposent, comme attirées les unes vers les autres par un mystérieux tropisme qu’on rêverait universel.
Le livre se referme sur treize portraits saisissants d’hommes et de femmes ayant pris part à l’un ou l’autre des ateliers. Treize visages sur fond noir, parfois à peine discernables. Treize paires d’yeux anonymes comme autant de voix timidement sorties du silence et de l’obscurité – le temps d’un livre – pour y replonger aussitôt.
Marina Skalova, Nadège Abadie, Silences d’exils, Lausanne, Éditions d’en bas, 2020, 168 p., 35 CHF.