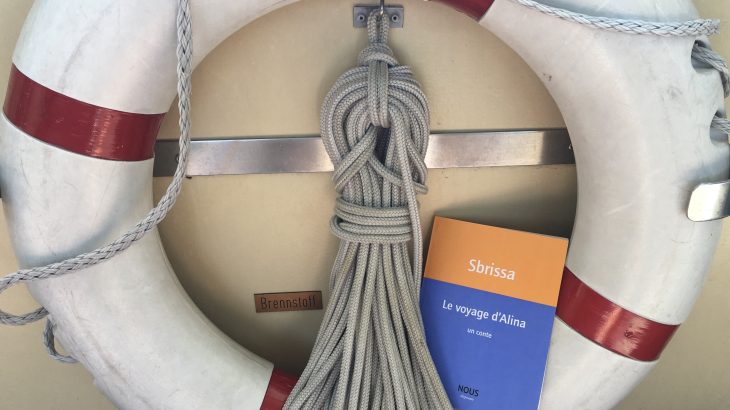Après plusieurs recueils de poèmes (Produits dérivés en 2016, Ici là voir ailleurs en 2018 et Tout tient tout en 2021, récompensé par un Prix suisse de littérature), Isabelle Sbrissa revient en 2022 avec Le voyage d’Alina. « Un conte », peut-on lire sur la couverture, genre que l’autrice genevoise explore pour la première fois. À cette occasion, elle embarque son lectorat dans une intrigante traversée en bateau, sans but avéré, vers l’inconnu. Une invitation au voyage que l’on accepte sans hésitation.
Des contes, il en existe un large éventail : conte de fées, conte philosophique, conte fantastique, conte noir, … S’il fallait lui imposer une étiquette, on pourrait dire du Voyage d’Alina qu’il s’agit d’un conte initiatique. Le voyage et la traversée qu’il implique figurent (sans grande surprise) l’idée d’un passage, de la transition d’un état à un autre. C’est ce que raconte la première couche du récit, en suivant le parcours de la jeune Alina Ilmur Philomène, qui fuit le domicile de ses parents pour s’engager vers une destination inconnue à laquelle l’adolescente tentera de donner forme en se projetant dans le carnet qu’elle a pris soin d’emmener avec elle.
Mais il ne faut pas s’y tromper. Derrière l’apparence archétypique de ce récit se cache un propos captivant et habilement agencé sur l’activité même de l’écriture, appréhendée elle aussi comme la traversée d’un vaste océan, encourageant l’organisation et la réorganisation du monde et des éléments qui le constituent. Ainsi construite, la narration multiplie les parallèles entre le coming of age et l’activité créatrice. On n’est donc nullement surpris de constater que la vie d’Alina est prise entre les mots et les choses. Elle semble s’écrire et se dessiner en même temps qu’elle se vit. Au début, son carnet est vierge (elle n’y a encore inscrit que son prénom) et l’infinité des possibles que suggère l’absence de mots se retrouve dans une narration sous-déterminée :
Évidemment, on pourrait donner des informations sur le bateau qui transporte Alina Ilmur Philomène, on pourrait décrire les cabines (s’il y en avait plusieurs), ou le pont, utiliser des termes comme bastingage, ou plus techniques comme mâchoire de bôme, nœud d’ajut, on pourrait parler de l’antifouling rouge contre l’épibiose si le navire était moderne, des badernes, des cordages lovés sur le pont, des yeux de corde, plus tard on le fera peut-être, on choisira (ou pas) si Alina vogue seule sur un radeau ou si le voyage a été mieux organisé, pas dit qu’on ait vraiment voulu lui épargner la mort à Ilmur, pas dit qu’on ait voulu faciliter la fuite de Philomène, ou garantir son retour, pas dit.
À peine enclenché, le récit donne ainsi naissance à un propos méta-narratif qui l’accompagnera en permanence. Comme le laisse entendre le motif des poupées russes qui matérialise la mise en abyme, le processus d’écriture est figuré dans son résultat même. Il ne s’agit pas de deux niveaux de lecture indépendants ; le fonctionnement de l’un dépend de l’autre, comme si l’histoire ne pouvait être racontée qu’à travers le récit de son écriture.
Dès les premières pages du conte, le lien entre fond et forme est explicité – le premier fait littéralement corps avec la seconde – et résonne comme un avertissement au lecteur. Lorsque Alina coupe les ongles de ses pieds, ils sont comparés à des mini-parenthèses. Une fois que le dernier a été sectionné et aligné à côté des précédents, un constat est posé : on pourrait en faire des digressions avec un tel matériel typographique. À partir de là, le monde et tous les éléments qui y participent deviennent autant d’outils de création. Cette correspondance entre les mots et les choses se retrouve dans les jeux de polysémie et d’homonymie qu’Isabelle Sbrissa glisse subtilement dans son texte : une feuille d’érable devient support d’écriture, les maux appris évoquent – en creux – les mots, Alina transporte les trésors qu’elle a emmenés avec elle dans une longue langue de tissu et enfin, les lignes qu’elle dessine dans son carnet sinuent à travers la couleur, comme des vers.
Ce passage de la ligne au vers permet en outre de soulever une question que l’on se pose avant même de commencer la lecture du Voyage d’Alina : comment est-ce que ce premier texte en prose trouve sa place dans l’œuvre, jusque-là exclusivement poétique, d’Isabelle Sbrissa ? Vouloir à tout prix cloisonner les deux genres restreindrait la portée de ce texte, qui évolue précisément dans un espace médian. Les (parfois très) courts chapitres s’appréhendent visuellement comme autant de poèmes, donnant au conte des allures de recueil, le tout renforcé par une langue travaillée, aux sonorités riches. Un exemple parmi tant d’autres :
La montagne fond ce matin, dans l’humide et la brume. Vitalité mangée par une nuit agitée. L’herbe est d’eau, l’entrain spongieux, les pas s’enfoncent. Le drapeau trempé n’ondule que mou. Pas de mue en un tout neuf du nom d’Alina Ilmur Philomène. Elle coule en cale.
On retrouve également l’intérêt d’Isabelle Sbrissa pour la combinatoire, un procédé auquel elle a déjà recouru à plusieurs reprises – notamment dans Produits dérivés – et qui consiste à réorganiser les éléments d’un ensemble selon plusieurs combinaisons successives. Dans Le voyage d’Alina, elle le met au service de son discours sur la création littéraire, proposant d’aller au-delà de la linéarité du roman et de créer une matière mouvante, ce qu’elle considère possible à la seule condition qu’une conscience combinatoire soit à l’œuvre. Elle la matérialise aussitôt en transformant Alina Ilmur Philomène en Almur Ilimène Philona, puis en Alili Lonamur Phimène, extrapolant un processus qui sous-tend la totalité du texte. L’identité de la protagoniste évolue en même temps que l’identité du récit qui, bien qu’il soit déjà figé sur la page au moment de la lecture, se présente toujours comme un texte mobile, en création. La présence de plus en plus marquée de la narratrice, qui passe du « on » au « je » et n’hésite pas à apostropher son lectorat, brise elle aussi l’illusion d’un texte fini, autonome, détaché de ses contextes de production et de réception. L’alternance entre le « je » de l’instance narrative et le « elle » d’Alina génère alors un dialogue qui finit de rapprocher les deux quêtes de sens, dans la vie et sur la page, par l’écriture et par la fuite.
Il faudrait alors corriger la mention figurant sur la couverture. Le voyage d’Alina, ce n’est pas « un conte », mais bien plusieurs contes. En racontant l’histoire d’Alina, Isabelle Sbrissa – à travers sa narratrice – raconte aussi (et peut-être d’abord) la genèse de son texte. L’expérience de lecture qui en découle est captivante, notamment grâce à la richesse de la langue mobilisée, qui parvient toujours à donner autant d’importance aux mots qu’aux choses auxquelles ils font référence. Le voyage en vaut la peine.
Isabelle Sbrissa, Le voyage d’Alina, Caen, NOUS, 2022, 96 pages, 23 CHF.