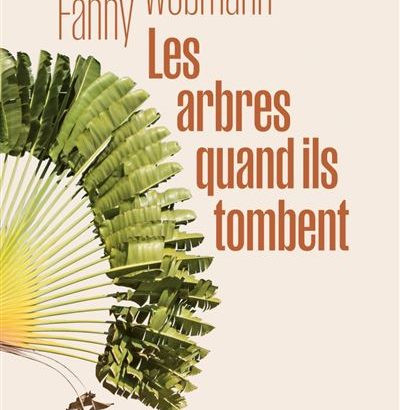Pris dans le tourment de la vie, tout s’enchaîne et on ne respire plus. Bien loin l’idéal du fleuve tranquille… ou presque ? Fanny Wobmann présente une autobiographie pour partir à l’aventure sans quitter son chez-soi.
Pour les stressés du quotidien, Les arbres quand ils tombent est une vraie petite oasis. Le livre déroule les souvenirs et questionnements d’une femme ayant grandi en Afrique et vivant maintenant en Suisse. Patchwork de messages, souvenirs et discussions, les paragraphes se développent au rythme de la respiration. Ce découpage permet une lecture fluide au rythme de chacun.
Fanny Wobmann sait écrire le quotidien en laissant suffisamment de place au lecteur pour l’investir. Comme dans chaque quotidien, des discussions surgissent et lorsque cela arrive, l’absence de marques de dialogue rend le tout très naturel ; le film se lance et on se retrouve dans la scène. Une question reste cependant sans réponse : pourquoi, dans cette écriture du quotidien où il y a des noms d’emprunt, le nom de l’enfant est-il abrégé par un simple « B. » ? Le détail provoque une perte de cohérence. J’aurais aimé voir tous les noms abrégés ou tous les noms remplacés. Un nom d’emprunt permettant tout aussi bien de préserver l’anonymat, ce « B. » fait tache.
Le plaisir de découvrir une tranche de vie
Tout au long du livre se pose la question de la légitimité. Peut-on raconter ses souvenirs sans « tricher » ? Une blanche, selon ses propres mots, peut-elle parler de sa vie à Madagascar ? Jusqu’où partager la vie intime vécue avec d’autres ? Il est vrai que bien poser une question est une étape cruciale dans la résolution du problème. Dans un premier temps, on ressent de la frustration, car la réflexion s’arrête au seuil des questions et les pistes offertes sont bien maigres. C’est un début de constat plus qu’une réflexion, et cela est bien dommage.
Et si ce n’était pas là l’objectif principal de l’œuvre ? Ces questions sont d’une complexité telle qu’une personne ne pourrait probablement pas y répondre seule. On assiste à une vie, telle que la vôtre ou la mienne, où toutes les questions ne reçoivent pas forcément de réponses. Le temps passe, on respire, les questions sont là, on y pense, on médite.
Peu d’enjeux sociaux sont abordés, pas la politique, pas le système de santé… ce qui « dés-exotise » cette île de l’autre bout du monde, comme si Madagascar était un acquis pour tous. Cela correspond tout à fait à la vision d’un enfant. L’accent est mis sur les camarades de jeu, un peu d’école et surtout les sensations vécues. On s’échappe, on s’imagine chahuté dans la voiture sur la route défoncée pour profiter des fruits frais et du sable chaud.
« Nos cheveux, mouillés en permanence, éclaircissaient et bouclaient. Nous mangions des mangues sur le sable, laissant le jus couler le long de nos mains, de nos bras, de notre torse, se mélanger au sel pour rendre notre corps plus poisseux encore. Nous nous rincions dans l’océan. »
Une écriture sans prise de tête
Fanny Wobmann a une écriture du quotidien pas si anodine que cela, qui peut rappeler celle de Joan Didion. Simple mais évocatrice, tout est dit sans que tout soit explicite. Après sa rencontre avec un homme qui a produit un film biaisé sur sa famille en Afrique : « Je ferme la porte derrière lui, mets les tasses dans le lave-vaisselle, rince la cafetière et la pose sur l’égouttoir. » Fin de chapitre. Une écriture qui s’efforce de dire ce qui est. Point. La démarche de véracité et de remise en question de préjugés n’en est que renforcée.
On ressort de cette lecture avec plus de questions qu’au départ, mais surtout avec un œil plus frais sur notre quotidien. Un livre bulle qui nous offre du temps et l’envie d’en savoir plus sur cette partie du monde.
Fanny Wobmann, Les arbres quand ils tombent, Quidam éditeur, 2024, 29,80 CHF, 200 pages.